ORPHICE ET EURYDÉE
Eli Lécuru – Maison trouble
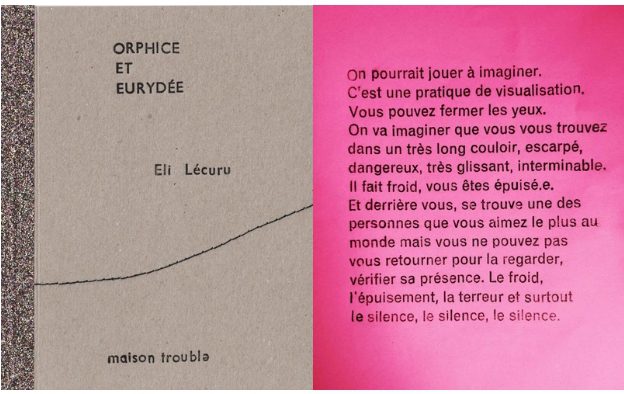
Ce texte est d’abord une proposition scénique hybride créée par l’artiste Eli Lécuru, qui tient autant de la performance que de la pièce de théâtre, de la chorégraphie ou du stand-up. Joué depuis 2015 dans différents contextes, il revisite le mythe d’Orphée et Eurydice et questionne le geste anodin mais fatal, celui du retournement d’Orphée dans le couloir des enfers.
Eli enquête sur la portée de ce geste à travers diverses explorations, de la figure biblique d’Ado à celle d’Amy Winehouse. Il en construit une nouvelle lecture et une perspective consciente des dynamiques patriarcales à l’œuvre.
Ce texte aux plusieurs vies met en jeu la fabrique de la pièce – dont les gestes ont été retranscrits en partie – et la fabrique d’un positionnement, toujours en mutation. La présente édition est basée sur la dernière variation en date.
Les éditions maison trouble nous offrent ici un magnifique petit livret, cousu et aux teintes bi-chromatiques rose/gris (comme on les aime). Le texte de Eli Lécuru s’intéresse en définitive à une théorie qu’il a développé, celle de la mise en scène des conditions de l’échec par la méta-structure (en s’inspirant du mythe de Orphée et Eurydice), considérant que en réalité Eurydice n’aurait jamais été derrière Orphée lors de sa remontée des enfers (dans le but de la sauver), ce qui le plaçait déjà en position d’échouer. Il s’inspire également de l’histoire tragique de la chanteuse Amy Winehouse, ayant rapidement été placée sur un piédestal au début de sa carrière d’artiste très talentueuse, et l’ayant également placé dans la position qui l’aura amené à perdre le contrôle de sa vie (pression médiatique, entre autre – voir le documentaire Amy qui relate l’histoire de cette personne aussi talentueuse qu’hypersensible). L’auteur termine également sur ces questions : qu’est-ce qui tue/porte/reste dans le regard ? Qui regarde quoi et quel pouvoir cela créé dans le récit ?
maison trouble est à l’intersection de la danse, la performance et la littérature.
le livre est pensé comme un laboratoire et un espace de porosité entre le geste, la parole et l’écriture ; les visions, imaginaires et récits qui en émergent travaillent à des mondes désirables.
maison trouble conçoit ses livres en semi-artisanal.
**
Revue CAFÉ (Collecte aléatoire de fragments étrangers)
#7 Résistance
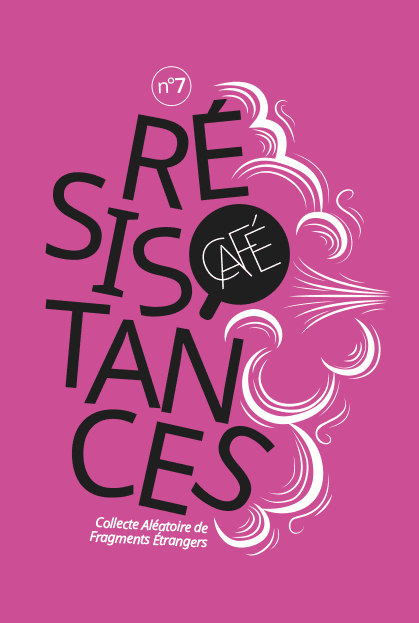
L’association et la revue CAFÉ sont nées en 2019 à l’Inalco, l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Porté par des traducteur·ices, alors étudiant·es en langues aussi diverses que l’arabe et, le coréen, le hongrois, le chinois et le kurde, le projet s’ouvre à toujours plus de diversité : au swahili, à l’inuktitut, au tamoul ou encore au breton. Chaque numéro de la revue CAFÉ est une Collecte Aléatoire de Fragments Étrangers : autour d’un thème choisi, elle rassemble des textes littéraires courts traduits depuis ces langues minorées.
»Traduire, c’est toujours un parti pris. Le nôtre, c’est d’accueillir le texte étranger en tant que tel, sans chercher à le faire passer pour un texte français. Cela ne signifie pas non plus l’essentialiser et le réduire à son origine. C’est porter attention à sa langue propre, c’est choisir de recréer en traduction les aspérités, les étrangetés voire les incorrections décelées à la lecture du texte originel. C’est avec un malin plaisir que nous bousculons quelquefois la langue française pour faire sortir les lecteur·ices de leur zone de confort. C’est cette position traductive qui nous sert de ligne éditoriale. » -Site internet de la revue CAFÉ
Dans ce numéro ayant pour thème »Résistance », on trouvera des textes traduit en français à partir de l’arabe, du turc, du tchèque, du portugais, du swahili, du serbo-croate, du tibétain, du grec, du russe et encore bien d’autres langues ! Tous orientés autour du thème, on y trouvera de la poésie, des nouvelles et mêmes des essais (savez-vous que le somali – langue orale dans son origine – n’a développé son équivalent écrit qu’en 1972 ?).
Chaque contribution est précédée d’une introduction et contextualisation de la langue ainsi que de la traduction effectuée, s’en suit la contribution de l’auteurice, en français et dans la langue d’origine (souvent avec l’alphabet de la langue, ce qui est à la fois rafraîchissant et magnifique de découvrir de nouvelles écritures). Très bien conçue visuellement, la revue CAFÉ nous permet de voyager à travers les yeux et les écrits des autres, de partout dans le monde, et est un réel plaisir à lire.
https://revuecafe.fr/pages/publications/cafe/07/resistances
**
Le Théâtre Carcéral
Éditions du Commun
Dans ce livre, l’autrice développe le concept de théâtre carcéral pour analyser la complexité des expériences sociales intramuros. Si la prison a des conséquences désocialisantes et désaffiliantes pour les personnes détenues, le drame social de la prison se joue avant tout dans les nouvelles formes de sociabilité qu’elle induit. Parler de théâtre carcéral permet notamment de saisir et de questionner les logiques de représentation et de rôles qui sont au cœur des interactions entre les différents acteurs sociaux des prisons (qu’ils soient conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, surveillant ou «détenu »).
Cet ouvrage s’inscrit pour nous dans un triptyque sur les questions carcérales et de probation que nous avons imaginé pour penser de manière complexe et critique ces sujets, au travers des livres Éprouver le sens de la peine, de Fabien Gouriou, Olivier Razac et Jérôme Ferrand sorti en janvier 2022 et Entre taule et terre de Sarah Dindo paru en janvier 2023.
Ce livre fascinant de Alexia Stathopoulos nous amène à nous questionner sur la manière dont le système carcéral est largement invisibilisé du commun des mortels – à moins d’y être directement impliqué. On y parle de la logique de la justice punitive (plutôt que réparatrice ou transformatrice), de la manière donc l’univers des prisons est volontairement cachées. On s’intéresse aussi à comment les dynamiques sociales se développent en prison dans un contexte pourtant très rigide où chaque geste est contrôlé par la structure (et des fois par les personnes elleux-mêmes qui se doivent de »performer » d’une certaine manière » dans cet univers aux règles bien présentes). La prison reste un processus d’exclusion qui touche en grande majorité les personnes les plus marginalisées de la société, il est donc important de se poser la question de comment la prison essaye de »ré-insérer » ces personnes dans la société dite »fonctionnelle ». Finalement on y parle de comment, dans cet univers aux codes bien précis, on évolue dans l’espace qui nous appartient, comment et si il est possible de créer du lien avec les autres personnes détenues, l’espace qui nous est alloué et pour faire quoi, et finalement – le rôle de la prison dans ce processus de déshumanisation des êtres détenues.
Le Théâtre Carcéral est un livre qui propose une approche originale et inventive de la relation à l’autre dans un univers aussi punitif et institutionnalisé que la prison.
**
Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire
Éditions du commun
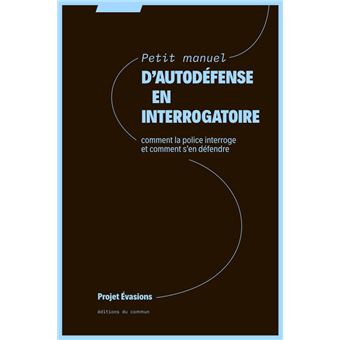
Ce livre arrive comme un manuel d’urgence dans un climat où la confiance envers les institutions policières s’est effondrée, au Québec comme ailleurs. Petit manuel d’autodéfense en interrogatoire, conçu par le collectif Projet Évasions, propose une lecture lucide, directe et sans ornement du rapport de force qui s’installe dès qu’un individu est confronté à la police. Ce n’est pas un essai théorique : c’est une trousse de survie.
L’intérêt du texte, dans le contexte québécois, tient à sa portée éducative et politique. Trop souvent, l’interrogatoire est perçu comme une formalité ou une scène de cinéma. Ici, on découvre sa réalité : un espace de pression psychologique où chaque mot, chaque silence peut être instrumentalisé. Le manuel traduit des savoirs militants en gestes concrets — comment préserver son intégrité, comment reconnaître les tactiques de manipulation, comment refuser le rôle que l’on veut nous faire jouer.
Dans une province où les mouvements sociaux, autochtones, étudiants ou écologistes continuent d’être surveillés, ce texte agit comme un miroir de nos vulnérabilités face à l’État et à sa police. Il ne se contente pas de dénoncer : il enseigne à se défendre, à parler moins, à écouter plus, à reprendre du pouvoir dans les interstices de la peur.
C’est un livre sobre et vital, qui nous rappelle qu’au Québec aussi, la parole — ou son retrait — peut être un acte de résistance.
**
Les différences invisibles
Maude Nepveu-Villeneuve
Éditions Écosociété
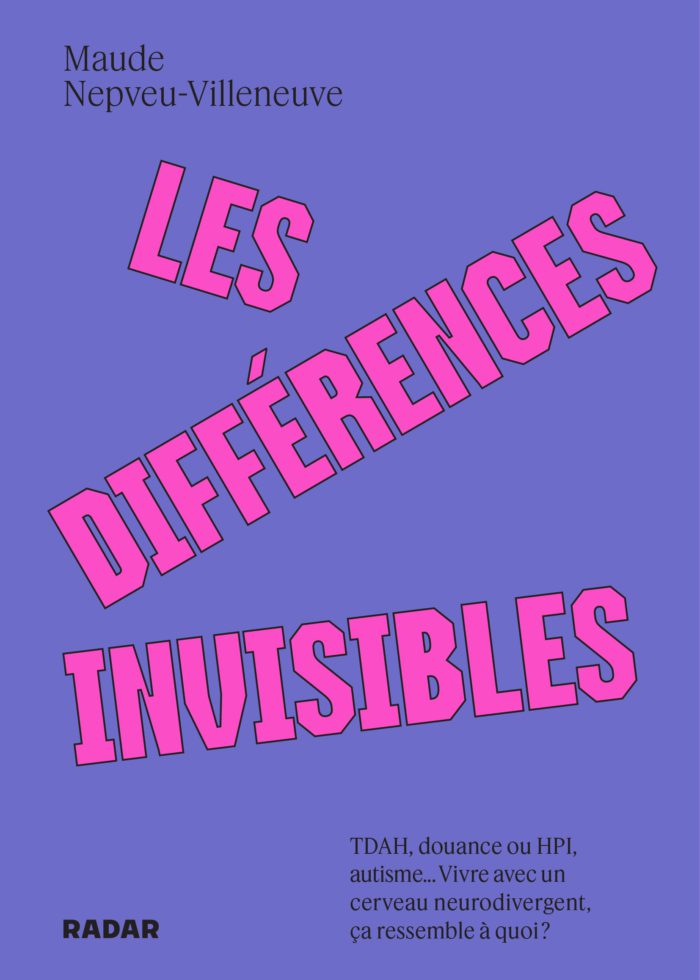
Avec Les différences invisibles, Maude Nepveu-Villeneuve pose un geste de clarté rare dans le paysage littéraire québécois. Elle écrit depuis l’intérieur de la neurodivergence — TDAH, autisme, douance — pour en révéler la beauté, la fatigue, la solitude, mais surtout la puissance de vivre autrement.
L’essai se lit comme une traversée lucide et sensible du quotidien de celles et ceux qui pensent de biais, qui ressentent trop, qui peinent à cadrer dans une société réglée pour le “neurotypique”. Sans victimisation ni suradaptation, Nepveu-Villeneuve propose une parole ancrée, pleine de nuances, qui refuse les clichés cliniques.
Au Québec, où les parcours de soins et de reconnaissance restent inégaux, ce livre agit comme un miroir nécessaire. Il nomme ce que beaucoup taisent : la difficulté d’exister dans un système qui exige la conformité cognitive. C’est une œuvre d’écoute, de dignité et de rébellion douce — une contribution précieuse à la conversation sur la diversité des esprits et des sensibilités.
Un livre à la thématique ô combien pertinente et qui, on l’espère, continuera de démanteler la normativité neurotypique des structures sociétales.
